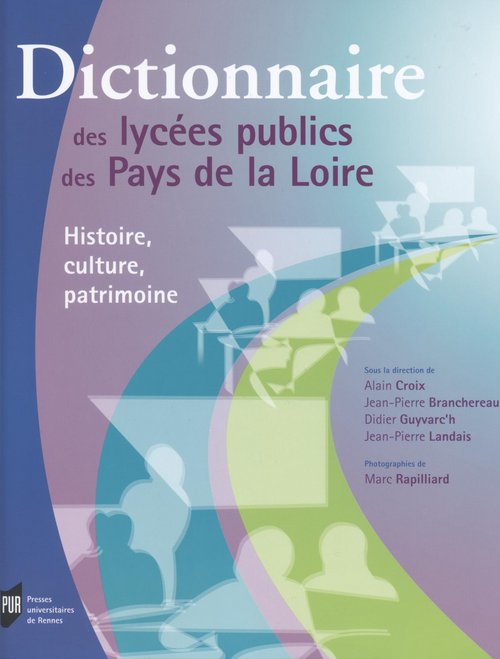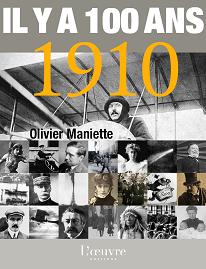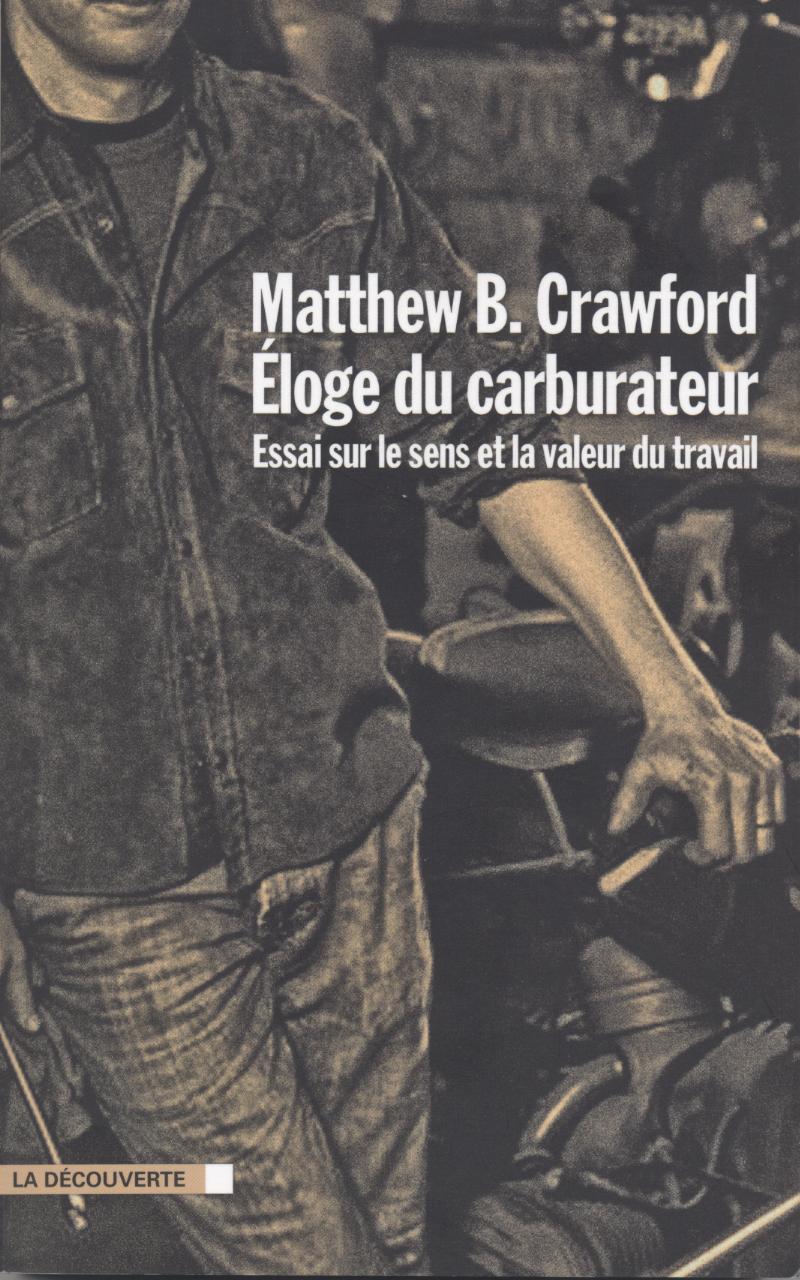- Accueil
- Galerie de photos
- Repères chronologiques
- Eugène Livet
- Inventaire Crypte
- Architecture et Parc
- 1910-2010
- Archives et Patrimoine technologique et scientifique
» Voir les dernières insertions
» Faire une recherche
» Plan du site
Radio du matin
Radio du matin
Ses pouces tapotaient fébrilement le volant. Un bruit mat, habituel, inconscient. Il fixait la route. Droit devant. Ligne blanche, continue.
Assise sur le siège à côté de lui, elle avait posé ses mains sur ses genoux. Elle regardait le paysage qui défilait à toute vitesse. Et la route. Ligne blanche, continue, droit devant. En silence.
7H30 annonça la radio, 7H30, l’heure de la météo. « Temps pluvieux sur le nord-ouest de la France. Quelques éclaircies au sud ». Belle journée en perspective ! « Les températures seront variables. Les maximales seront atteintes en début d’après-midi ». Ben tiens, pour changer ! Puis la voix monocorde associa des noms de ville à des températures.
Dans la voiture, ils n’écoutaient pas. Ni le père ni la fille. Pas vraiment, en fait. Ils n’avaient pas encore compris à la radio, que la véritable température, elle est dans le cœur des gens. Non, ils n’avaient pas compris. Dans la voiture, climat tempéré. Légère brise de tendresse. Fraîcheur endormie du réveil trop matinal. Nuage gris des habitudes.
7H35, flash info. Les doigts s’immobilisèrent sur le volant. Les mains se crispèrent un peu sur les genoux. Au milieu de la route, la ligne blanche, discontinue, filait vers l’horizon.
D’abord le foot. Il poussa un juron lorsqu’il entendit le résultat peu glorieux de l’équipe de France. Pourtant, il savait déjà. Il connaissait le score du match depuis la veille, et il savait bien que, foot ou non, la France n’avait plus grand chose de glorieux.
Puis les nouvelles réformes. Les grèves. Enfin ce qu’il en restait. Fin des trente cinq heures. Virage à droite. Il fit glisser le volant sous sa paume. Surtout ne pas dépasser la ligne continue. Mais bien sûr, ils expliquaient, les patrons paieraient les heures supplémentaires. Bien sûr. Et puis, ils ajoutaient, de toute façon, jamais un patron ne pourrait faire travailler un ouvrier au delà de ses possibilités. Jamais, évidemment. Elle serra les dents. Très fort. Jamais évidemment. Devant ses yeux, la route devenait floue, restait la ligne blanche.
Chômage. Mauvaise nouvelle. Le chômage augmente. Le nombre de travailleurs pauvres aussi d’ailleurs. Il détourna le regard pour contempler sa fille. Profil figé. Qu’allait-elle devenir ? Il aurait voulu qu’elle ne se heurte pas au monde. Pas à ce monde là. Il aurait voulu la protéger. Mais il ne pouvait pas. C’était trop dur. Il préféra détourner la tête pour regarder la route. Et la ligne blanche au milieu. C’était plus facile. Pas besoin de réfléchir. Question de sécurité.
Et puis un petit débat entre hommes politiques sur les raisons du non Irlandais. Ils n’avaient pas voulu de l’Europe. Ah les méchants ! Vraiment, ce que les gens peuvent êtres renfermés sur eux-mêmes ! Ils refusent le progrès ! Ils refusent l’Europe !
Elle glissa un regard grimaçant vers son père. Ses doigts s’étaient crispés sur le volant. Intérieurement, il bouillonnait. Il attendait l’homme politique assez intelligent pour comprendre que les gens n’étaient pas contre l’Europe. Qui pouvait être contre l’Europe aujourd’hui ? Qui voudrait refaire les frontières, comme il disait souvent. Non, les gens n’étaient pas contre l’Europe, ils étaient contre cette Europe-là. Mais aucun homme politique n’avait assez de clairvoyance, ou d’audace pour le dire. Elle vit les jointures de ses doigts devenir aussi blanches que la ligne au milieu de la route. Aucun.
Un feu passa au rouge. Il rétrograda. Ralentit. S’arrêta net. « Les meurtriers présumés du petit Valentin ont été arrêtés hier soir ». Il frémit. C’était effrayant. Le commentateur parla d’indices, de traces de sang. Il fixait le feu. Rouge. Comme une goutte de sang. Il sentait sa gorge se nouer. Le feu restait rouge. N’osait pas détourner les yeux. Il avait trop peur. Trop peur de croiser son regard à elle.
Une grosse boule bloquait sa gorge. Il avait honte. Honte de ce monde où les hommes assassinaient les enfants. Honte de cette société où les journalistes se repaissaient de scènes macabres. Honte de tous les auditeurs qui écoutaient et laissaient le venin de la peur et de la haine s’insinuer en eux. Surtout, il avait honte de lui. Honte de son impuissance. Honte de laisser une terre aussi sordide à ses enfants. Honte d’avoir peur. Honte surtout de ne pas avoir le courage d’appuyer sur le bouton de la radio pour l’éteindre.
Après tout, quel besoin ils avaient de savoir ça ? Quel besoin ils avaient de savoir qu’un enfant avait été tué ? Et comment ? Et pourquoi ? Le meurtre devenait un conte sadique à suspense. Comment la police avait retrouvé les assassins ? Qui étaient ces gens ? Et comment vivaient -ils ? Et ce stupide feu qui restait rouge ! « Nous sommes soulagés que les coupables aient été identifiés », affirmaient les parents et les proches de la victime. « Ils doivent être sévèrement punis ».
La tâche rouge sang s’évanouit, le feu passa au vert. Il enfonça la pédale de l’accélérateur. Attendez ! Attendez, on n’est pas encore sûr qu’ils soient coupables ! La goutte de sang avait disparu du feu tricolore. Pas l’énorme boule dans sa gorge. Attendez...
Attentat à la voiture piégée à Bagdad. Un de plus un de moins ... C’était presque tous les jours. Six morts dont cinq civils. Tellement banal. Les journalistes ne s’éternisèrent pas. Ça n’intéressait plus personne. Le paysage s’enfuyait le long de la vitre. Arbres, maisons, fossés, buissons, champs, voitures... A toute vitesse.
Ses mains glissèrent de ses genoux à sa ceinture de sécurité. Ses doigts serrèrent le tissus tendu contre sa hanche. Elle avait le vertige. Elle pensa à son gentil professeur d’histoire géographie, à ces réflexions profondes sur la mondialisation, sur le pétrole. Elle ferma les yeux. Et les hommes alors ? Ils devenaient quoi dans l’histoire et la géographie ? Ses yeux brûlaient. Le paysage défilait trop vite.
Elle pensa à ces gens, des gens normaux, des civils. Ils avaient eu une vie. Une famille. Des amis. Ils avaient eu une vie, un travail, une maison peut-être. Et puis un matin, ils étaient passés par là. Ils étaient morts. Broyés par la grande machine de la géopolitique. Presque oubliés du monde. Elle inspira précipitamment. Elle avait l’impression de se noyer. Pourquoi eux ? Elle se força à respirer calmement. Elle revoyait le visage brouillé de son professeur d’histoire. Les hommes ont inventé la politique, depuis, la politique a oublié les hommes. Ses mains étaient crispées sur sa ceinture de sécurité. Ses yeux la piquaient.
Il ralentit, mit son clignotant, tourna à gauche. Ils étaient presque arrivés. Il suivit la ligne blanche, discontinue. Bientôt ils traverseraient le petit pont de pierre. Bientôt, il retrouverait son bureau, son travail, quotidien, rassurant.
Oui, quotidien et rassurant. Surtout ne pas changer ses habitudes. Surtout ne pas rouler sur la ligne blanche. C’était exactement ça. Bien rester dans les rangs. Habituels, rassurants. Éviter de trop réfléchir. Laisser la radio anéantir son moral jusqu’au bout. S’informer, mais surtout, ne pas réfléchir. Comme tout le monde. Et puis suivre la ligne blanche. Ne pas doubler quand la ligne est continue.
Ils étaient presque arrivés. Presque au bout de leur trajet quotidien et familier. La radio parlait paisiblement de l’environnement. Des signatures manquantes du protocole de Kyoto. De l’effet de serre. De la forêt amazonienne grignotée. Elle avait toujours les mains crispées sur le tissu tendu de sa ceinture de sécurité. Il avait toujours une boule énorme qui lui bloquait la gorge.
Il pensait à ses bouquins d’écologie, à ses petits plants de tomates au fond du jardin. Elle imaginait un avenir apocalyptique, sans eau potable pour son poisson rouge, sans arbres dans le jardin public. Elle revoyait chacune des grandes catastrophes naturelles qui avait secoué la planète comme un tremblement de fièvre. Chacune d’elles lui semblait une aiguille qui s’enfonçait dans son cœur. Elle avait mal. La terre était malade. Par la faute des hommes. Par leur faute à eux. Les larmes lui montaient aux yeux. Tu sais que je t’aime petite planète ? Tu sais que je t’aime. Oh ! Bats-toi. Je t’en prie, bats-toi. Ses yeux brillaient comme des étoiles.
Ils étaient arrivés. Enfin. Il recula, fit son créneau, se stationna bien au milieu de sa case, bien à sa place, sans dépasser. Elle enfonça rageusement le bouton de la radio. Il coupa le moteur, un peu surpris. Leurs regards se croisèrent. Le père, la fille. Les mêmes yeux. Exactement. Bleus pailletés d’or. Le même regard hagard. Le même gouffre de ciel débordant de doutes et d’angoisse. Oui, le père et la fille dans un instant hors du temps, plongés dans la même détresse, se posant les mêmes questions.
Sur leurs iris, les paillettes d’or étaient comme des éclats de lumière éteints. Comment pouvaient-ils vivre ? Comment pouvaient-ils continuer à vivre ? Et pourquoi ? Pour qui ?
« Papa, le monde est pourri ! »
Avant d’avoir achevé sa phrase, elle savait qu’elle avait tort. Dans les yeux de son père, les paillettes d’or s’étaient embrasées d’amour et le bleu débordait d’espoir.
Aude Allard, Radio du matin, 2009. Tous droits réservés.