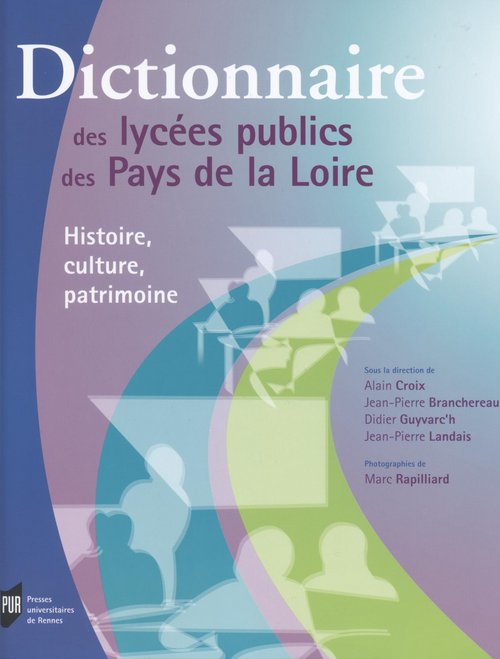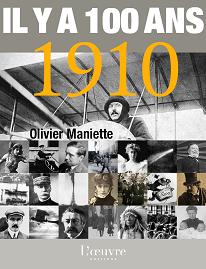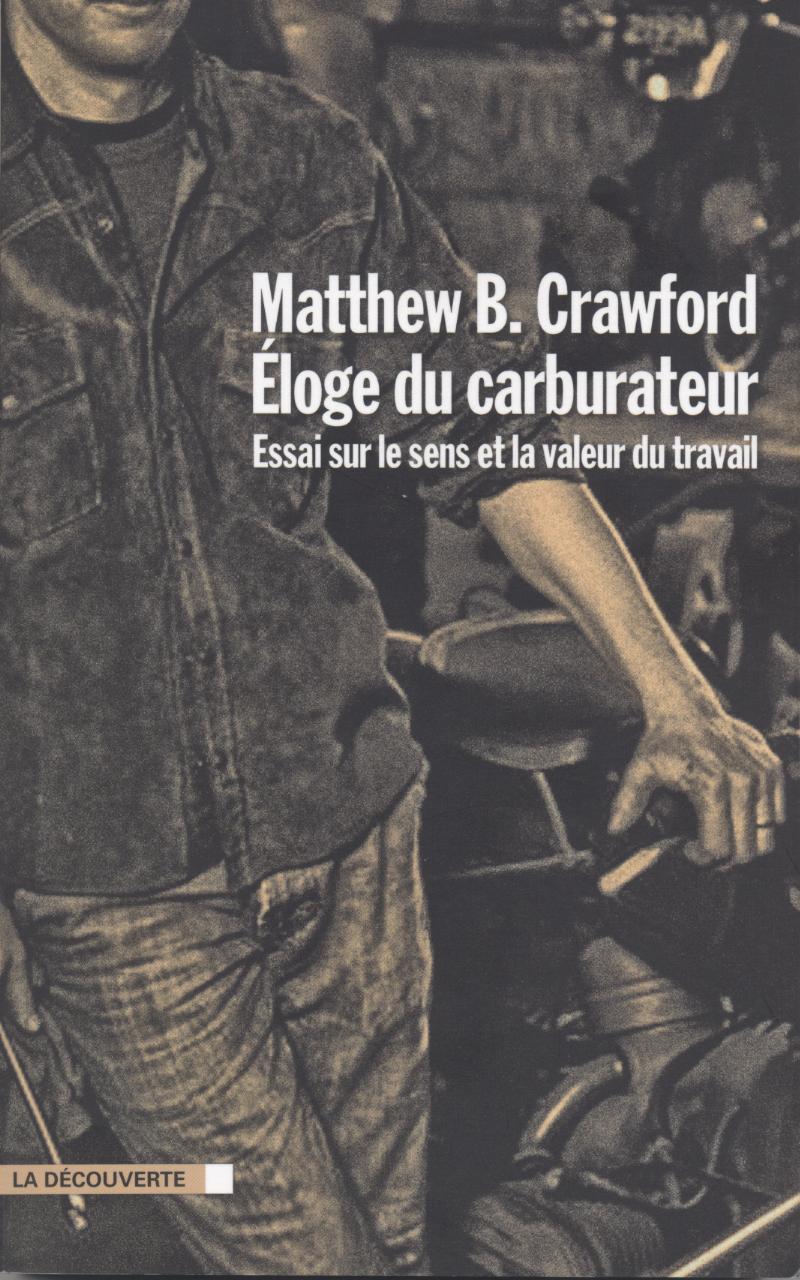- Accueil
- Galerie de photos
- Repères chronologiques
- Eugène Livet
- Inventaire Crypte
- Architecture et Parc
- 1910-2010
- Archives et Patrimoine technologique et scientifique
» Voir les dernières insertions
» Faire une recherche
» Plan du site
Le studio Folgoas
Ce que disent les photos
Les photos scolaires ont peu changé au cours des décennies. Sauf dans les grandes classes où l’on se déguise de plus en plus, comme ici, la terminale S4 du lycée Clemenceau de Nantes, prise par Claude Folgoas, photographe scolaire à Quimper. : Studio Folgoas
Influence de tous ces sites Internet qui proposent, à travers elle, de retrouver ses anciens copains ? Voilà un cliché qui ne se démode pas, à l’heure du numérique... « J’alterne : un gars, une fille. Je fais asseoir les petits devant. Ceux du deuxième rang restent debout. Au troisième, ils montent sur une chaise. Je réalise une quinzaine de clichés par classe. Faut les gérer, les gamins ! Je leur explique que le moment est important, qu’ils seront contents de se revoir sur cette image quand ils auront mon âge. »
Une histoire mouvementée
Trente ans que le rituel est le même pour Yannick Letoqueux, 57 ans, photographe à Ploubalay (Côtes-d’Armor). Il reprend au printemps les photos d’écoliers. Le printemps, comme la rentrée, c’est la belle saison pour un genre presque aussi vieux que la photographie. Il a fait, dès 1882, la renommée de MM. Tourte et Petitin, dont la société, emblématique, existe toujours à Arcueil (Val-de-Marne).
Deux cent cinquante professionnels pratiquent aujourd’hui, en France, « la photo individuelle et de groupe en établissements scolaires ». Une centaine ne vivent que de ça. « C’est l’une des seules activités qui ne fonctionnent encore pas trop mal dans la profession », constate François Thill, président de la Chambre syndicale de la photographie scolaire.
Pourtant, les photos individuelles, proposées aux parents dans des pochettes avec la traditionnelle photo de groupe, ont eu une histoire mouvementée.
Impulsées par l’État pendant la Première Guerre mondiale pour que les poilus aient, au front, une image de leurs enfants, elles ont été interdites en 1927 et 2002, sous la pression de photographes de quartier et de parents. Les uns dénonçant un business déloyal, les autres une vente forcée.
Depuis 2003, elles sont réautorisées, à charge pour les photographes de respecter un code de bonne conduite. « Désormais (entre autres) : le format des photos doit s’écarter de celui des photos d’identité. C’est la coopérative scolaire qui fixe le prix de vente aux familles (entre 10 et 15 € la pochette que nous leur faisons à environ 7 €). »
« On en place entre 80 et 90 %, poursuit François Thill. C’est très demandé, dans tous les milieux. » Il y a même des parents qui ramènent un enfant malade « le jour de la photo » pour qu’il ne soit pas gommé du souvenir de la classe. « Ils en saisissent toute l’importance depuis le développement de ces sites Internet qui permettent de retrouver d’anciens camarades. »
Et l’esthétique du cliché lui-même, dans tout ça ? « Rien de révolutionnaire depuis l’arrivée de la couleur », sourit Yannick Letoqueux, à Ploubalay, devant une photo de 1936 sur laquelle figurent son père et son oncle.
À croire que le classicisme des rangs d’oignons assure leur pérennité. « Sauf dans les lycées. Sur le modèle des grandes écoles, on s’y déguise de plus en plus. Une preuve de l’importance de l’image aujourd’hui. Dans les années 1970, on s’en fichait », note François Thill. Et on achetait presque deux fois moins de photos. Parce qu’il y avait aussi moins de foyers recomposés, qui multiplient la demande...
Pascale VERGEREAU. Ouest-France, 27 mai 2009.